Recherche
Chroniques
ouvrage collectif
La violence en musique
Dans leur collection Mélotonia qui explore « les notions de matière et d’énergie, envisagées comme des concepts fédérateurs de l’art musical, par-delà la diversité des domaines de la musicologie », les Presses universitaires de Lyon proposent cet ouvrage passionnant qui, sous le titre coup de poing La violence en musique, présente, sous la direction de Muriel Joubert et de Denis Le Touzé, une quinzaine de sujets traités par autant d’auteurs. « Réflexion sur la violence comme énergie intra-musicale, en lien avec le contexte qui l’a fait naître, le geste artistique qui a précédé et la perception qui en découle », comme l’annonce Muriel Joubert, l’ouvrage est ouvert par Tue, préambule par lequel Lambert Dousson [lire notre chronique de L’espace des possibles] commente « la musique de la violence en images, la violence de la musique des images, la musique des armes à feu » telles que données à entendre, à très fort volume, comme à voir par le plasticien et musicien Christian Marclay via son installation audiovisuelle Crossfire (2007). « Aucune musique n’a jamais contraint un être humain ou une collectivité à danser ou à marcher au pas, à tuer ou à mourir, ce que la politique et les armes à feu parviennent très bien à faire toutes seules, avec ou sans accompagnement musical », nous rassure-t-il, tout en soulignant l’ambiguïté entre violence musicale et violence réelle – « les mélodies amorties de la muzak diffusée dans n’importe quel McDonald’s sont l’exemple parfait d’une violence économique disséminée dans la non-violence musicale », par exemple. Riche et pertinente introduction aux quatre parties selon lesquelles le volume s’articule : Ancrages rituels et primitifs ; Violences et scènes opératiques et filmiques ; Politique, guerre et violence : la violence musicale dans le société ; enfin La violence comme catégorie esthétique.
Trois articles illustrent Ancrages rituels et primitifs. Avant que Luis Velasco-Pufleau fasse lien avec le chapitre suivant à travers Musique et violence : questions d’épistémologie, Anetta Floirat, auteure de Karol Szymanowski à la rencontre des arts (Delatour, 2019), immerge le lecteur dans la Russie du début du XXe siècle où un néoprimitivisme puise inspiration dans un folklore souvent réel, parfois fantasmatique, « exploitant les éléments les plus archaïques où la violence est le plus présente ». Le style scythe de Prokofiev – Expression de violence ou style violent ? fait approcher le mythe du barbare pur et rebelle, puisé dans les traditions komies, polovtsiennes ou encore tatares, instrumentalisé comme critique de la civilisation occidentale décadente. Autrement dit : l’européen raffiné face à l’insoumis asiate, compris comme mu par une force vive et authentique. Ici nous fréquentons les peintre Roerich, Gontcharova et Malevitch, ainsi que l’avocat-compositeur Vladimir Senilov (1875-1918), élève de Rimski-Korsakov et de Glazounov qui, outre d’avoir mis en musique quelques poèmes d’Akhmatova, inaugurait l’application musicale de cette vogue avec Les Scythes, en 1912. Si Stravinsky s’y engage avec son Sacre du printemps (1913), œuvre ayant eu plus de retentissement hors de Russie, c’est Prokofiev le compositeur assimilé à ce style, depuis sa Suite Scythe (1916), adaptation pour le concert du ballet Ala et Lolly refusé par Diaghilev (Ballets Russes). « Chaque tableau intègre des événements propices à la violence. L’atmosphère obtenue est clairement celle d’un archaïsme païen que la musique rendra réellement barbare. » L’année suivante, la cantate Sept, ils sont sept pour ténor, chœur et orchestre sur des vers d’Appels antiques de Balmont, s’inscrit dans ce courant scythe, bien que son sujet puise dans des tablettes d’argile mésopotamiennes de près cinq mille ans, les Akkadiens étant identifiés par Henry Rawlinson, traducteur d’Hérodote et spécialiste de la région, « comme les Scythes de Babylone ». Dans cet opus, « le rythme du pouvoir magique des rituels, conçu comme source d’énergie sauvage, devient le paramètre dominant. Le rythme scythe consiste en une masse de notes régulières, marquées, dont se détachent des événements. L’écriture rythmique est galvanisée par l’utilisation de l’ostinato qui permet de faire ressortir l’énergie barbare ». D’autres pages de Prokofiev intègrent par endroits le style scythe, comme le Concerto en sol mineur Op.16 n°2 (1913/1923), le ballet Chout (1915), l’opéra L’ange de feu (1927), mais encore les partitions de cinéma que sont Alexandre Nevsky (1938) et Ivan le Terrible (1946). Quant à Joseph Delaplace, il interroge l’infiltration de la créativité musicale d’aujourd’hui par un désir de bruit au fil de Du mythe à la musique saturée – Composer, avec quelle violence ?
Quatre textes font la deuxième partie (Violences et scènes opératiques et filmiques). Celui d’Armelle Babin sonde l’orage à travers deux opéras récents, Written on skin et Lessons in love and violence (respectivement 2012 et 2018) qui marquent la collaboration entre le dramaturge Martin Crimp et le compositeur George Benjamin [lire nos chroniques des DVD de 2014 et 2019]. Les intrigues, inspirées de l’histoire ou de légendes médiévales, sont toutes deux violentes, qu’il s’agisse du Cœur mangé, récit occitan du XIIIe siècle ou, au siècle suivant, de la fin du roi Edouard II d’Angleterre telle que portée au théâtre en 1592 par Christopher Marlowe. « Des poèmes symphoniques de Liszt ou de Smetana aux musiques de films […], on retrouve les mêmes principes musicaux dès qu’il s’agit d’évoquer la guerre : une écriture verticale, tonale avec la prédominance du mode majeur ou archaïsante avec peu de modulations, des thèmes martiaux, des épisodes de fanfare, la caisse claire accompagnée de nombreuses percussions, un tempo de marche et des massages hymniques », écrit Cécile Carayol en prélude à sa contribution, Violence latente de la musique dans le film de guerre. Pourtant, « loin de tout stéréotype, c’est par ses dimensions contemplatives et minimalistes que la musique occupe une grande place dans les films de guerre », révèle-t-elle. Infiltrée d’hymnes nationaux, les bandes originales des films guerriers se taisent lorsque le combat fait rage. L’auteure ouvre sur « une étude plus vaste autour de l’idée d’une musique [de cinéma] mettant en évidence l’individu face à la violence, qu’elle soit physique ou psychique, dans divers genres ». Les deux autres articles se penchent sur le XVIIIe siècle. Si, contrairement à la shakespearienne, la tragédie française jamais ne montre le meurtre sur sa scène, il en ira de même des livrets conçus par Métastase pour l’opéra italien, rappelle Nathanaël Eskenazy dans Altro giorgo di sangue d’orro : morts tragiques, morts violentes dans l’opéra italien de la fin du XVIIIe siècle. Encore le lieto fine vient-il déjouer les dénouements malheureux en ces temps de Lumières. Pourtant, la règle finit par se retourner au fil des décennies, si bien qu’en « proposant des dénouements où la mort est à l’œuvre, deux librettistes de la fin du siècle, Antonio Sografi et Gaetano Sertor, offrent à leur compositeurs la possibilité d’élargir considérablement un cadre musical qui paraissait figé dans le marbre ». Violence politique, violence du crime passionnel, violence des sentiments, presque toujours : « la musique fait totalement corps avec le texte qui cherche à être très expressif et à toucher de plein fouet la sensibilité de l’auditeur ». Et de conclure : « la violence sur scène aura permis aux librettistes et aux compositeurs de repenser le genre en profondeur ». Quant à Pierre Saby, il s’attache à un seul ouvrage, soit la première tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie (1733) [lire nos chroniques de la production d’Ivan Alexandre à Toulouse puis lors de sa reprise à Paris, de celles de Jonathan Kent et d’Aletta Collins]. Représentation de la violence dans la tragédie en musique : la passion d’Hippolyte selon Pellegrin et Rameau sonde les relations entre le genre parlé et la tragédie en musique, partant qu’à l’opéra, « le passage à l’acte représenté renverse les principes de la tragédie et investit […] le domaine de la violence, voire de l’horreur » à travers la fin d’Hippolyte dans l’œuvre de Rameau, mais aussi dans les pièces d’Euripide, de Sénèque et de Racine, l’abordant dès lors selon le livret de Simon-Joseph Pellegrin.
Politique, guerre et violence : la violence musicale dans le société constitue la troisième partie de La violence en musique, qui compte cinq épisodes. Avec Louisa Martin-Chevalier nous embarquons une nouvelle fois pour la Russie du début du siècle dernier. La révolution d’Octobre reconfigure l’idéologie, la politique comme la vie sociale mais encore les arts. L’avant-garde musicale russe et la révolution de 1917 raconte les esthétiques qui suivirent Octobre, propagées par le penseur Chklovski, le poète Maïakovski ou encore Tatline, le sculpteur constructiviste, explorant plus précisément les propositions et le destin des compositeurs Arseny Avraamov, Arthur Lourié, Alexandre Mossolov et Nikolaï Roslavets. Ici nous retrouvons Zavod Op.19 (1927), « symbole de l’essor industriel soviétique [qui] incarne le constructivisme musical soviétique ». Plus radical encore que Mossolov – il « propose de brûler tous les pianos pour jouer de la musique nouvelle et considère Bach comme “un grand criminel devant l’histoire” » tout en précédant John Cage d’une vingtaine d’années dans l’usage du piano préparé –, Avraamov créée en 1922 son incroyable Symphonie des sirènes, à Bakou, destinée à un public prolétarien : « grandiose, le spectacle se déroule dans l’ensemble de l’espace urbain, transformant la ville en véritable laboratoire scénique : les sirènes des usines, les moteurs des hydravions, les sifflets, les vingt-cinq locomotives à vapeur, les bateaux, les bruits de camions et les klaxons de la ville constituent les instruments d’une orchestre moderne et gigantesque, deux batteries d’artillerie remplaçant les percussions, les canons faisant office de caisses claires et la grosse artillerie de grosses caisses ». Il sera mis un terme à ces expériences dès la décennie suivante où l’avant-garde se voit rejetée par le régime soviétique qu’il remplace par le réalisme socialiste. Le parcours de Roslavets fait frémir : lui qui avait « exalté la rhétorique révolutionnaire bolchévique de l’homme nouveau » et, pour ce faire, s’investit à titre gratuit dans l’enseignement, il serait soudain attaqué pour formalisme, et bientôt condamné, comme ennemi du peuple, opportuniste et même saboteur, à renoncer à son métier de compositeur et à s’exiler à Tachkent – son nom ne réapparaîtra dans les encyclopédies que dans les derniers temps de l’URSS. Au printemps 1944, dans la misère, Avraamov meurt ; trois mois plus tard, Roslavets disparait à son tour, oublié de tous. Quant à Mossolov, il faillit connaître les travaux forcés n’était l’aide de Nikolaï Miaskovski et d’Arthur Glière, et mourut dans l’abandon en 1973. C’est de violence idéologique qu’il est ici question, donc. « Fondée sur une conception très violentes de la libération de l’individu, la musique des Doors […] trouve une assise qui irrigue tant la musique du groupe sur scène que celle qu’il enregistre sur support discographique » : voilà qui entame Jim Morrison et les Doors, entre révolte métaphysique et musique rock, un article signé Antoine Santamaria.
Avec L’opéra entre violence coloniale et marronage esthétique, Nicolas Darbon [lire notre chronique de ses Musiques du chaos] démontre l’arrivée très tardive des questions raciales et coloniales sur nos scènes lyriques. « Les sacrifiées de Thierry Pécou est le seul opéra qui développe un tel thème parmi les cent vingt qui ont été subventionnés par le Fonds de création lyrique française (FCL) entre 2014 et 2019 » [lire notre chronique du 11 janvier 2008]. L’auteur se penche sur les opéras relatant vraiment la violence coloniale. Mieux qu’à le paraphraser, laissons-lui pleinement la parole, qu’il possède si précise : « le terme de marronnage renvoie prioritairement à la condition des Noirs ou considérés comme tels, des métis. La notion de marronnage esthétique désigne la volonté de contester le système social de façon plus ou moins explicite dans le domaine de la musique ou des dialogues. Le marronnage, au sens premier, est la condition des esclaves qui ont fui la plantation. […] L’idée est la résistance culturelle, actionnée par des librettistes, des compositeurs, des danseurs de toutes origines et de tous horizons ». Du ballet de Minkus, La Bayadère (1877), avec sa danse de négrillons, à la comédie musicale Québecité (2003) qui impose langue et culture anglosaxonnes à l’identité cependant francophone du Québec, en passant par la comédie lyrique Paul et Virginie (1791) de Rodolphe Kreutzer et sa critique feutrée, l’opéra en un acte Le nègre aubergiste (1793) de Charles-Jacob Guillemain qui se déclare en faveur d’un colonialisme éclairé, dira-t-on, l’apologie du bon nègre et du généreux Blanc grand seigneur avec Adonis, mélodrame en quatre actes avec chansons de Béraud et Rosny, donné au Théâtre de l’Ambigu-Comique en 1798, le drame lyrique Elisca ou L’amour maternel (1799) de Grétry qui évoque la barbarie primitive, la censure de Pyracmond (1826) d’Henri-Montan Berton, dont le personnage « incarne ce que Frantz Fanon appelle le “nègre-biologique-sexuel-sensuel-et-génital” », et par Voss (1986) de Richard Meale où l’emprise coloniale se trouve justifiée par les valeurs progressistes occidentales, on compte peu d’ouvrages honnêtes et courageux. Nicolas Darbon, qui publiait Musique et Littérature en Guyane aux Classiques Garnier en 2018, révèle les audaces plus critiques de Jean-François Le Sueur dans son drame lyrique Paul et Virginie ou Le triomphe de la vertu (1794), l’esprit frondeur et progressiste qui anime l’opéra L’Africaine (1865) de Meyerbeer [lire notre chronique du 11 mars 2018], le réalisme de celui de Křenek, Jonny spielt auf (1927), interdit sous le IIIe Reich, et présente l’avènement d’opéras afro-américains avec Treemonisha (1910) de Joplin [lire nos chroniques du 31 mars 2010 et du 19 octobre 2022], Porgy and Bess (1933) de Gershwin [lire nos chroniques du 4 décembre 2007, des 25 mai et 2 juin 2008, du 23 novembre 2016 et du 7 juillet 2019] et The Emperor Jones (1935) de Gruenber. Plus proche de notre temps, Michaël Levinas s’empare des Nègres de Jean Genet [lire notre chronique du 24 janvier 2004]. Quant à elle, Élise Petit signe Mise en musique de la violence paroxystique dans le système concentrationnaire nazi qui préfigure son commissariat de l’exposition La musique dans les camps nazis ouverte au Mémorial de la Shoah entre avril 2023 et février 2024.
Passé l’interlude de Winfried Veit, Peut-être faut-il quelque chose de l’ordre de la violence, de la destruction, de la douleur, de la mort, pour parler de la vie, l’ouvrage est conclu par La violence comme catégorie esthétique, ultime réservoir qui contient trois contributions. La musique de Schönberg, Berg et Webern a violenté les habitudes d’écoute du public viennois. Avec Un langage qui ne suffit plus : l’expressionnisme viennois et la violence du sentiment, Dimitri Kerdiles interroge ce qui, dans la radicalité des procédés compositionnels de ces musiciens, comme le cri, put choquer l’auditeur en leur temps. Pourtant, « bien loin de prôner une tabula rasa, les Viennois revendiquent une filiation qui, par Mahler, Debussy et Reger, hérite de Wagner, de Brahms et remonte en droite ligne au classicisme ; une tradition de l’innovation au nom de laquelle ils justifient précisément les hardiesses stylistiques de leurs œuvres en se présentant comme les hérauts de la plus haute idée de l’art ». C’est la nouvelle syntaxe adoptée par ces créateurs qui déroute assez les mélomanes pour qu’ils se déchaînent, comme lors du fameux Skandalkonzert du 29 mars 1913. L’auteur analyse les différents cris qu’invite cette syntaxe violente. L’Ars Nova et l’évolution de la polyphonie médiévale : violence et cristallisation d’un basculement musical et poïétique d’Amaury Duret pointe les « rencontres harmoniques remarquables, [les] conduites mélodiques ou encore [le] traitement systématique des durées » des œuvres singulières de l’Ars nova. « On peut associer ces différents aspects à une certaine forme de violence propre à la rupture moderniste vis-à-vis d’un langage musical, rupture dont le XXe siècle a connu quelques exemples. » Terminons ce compte-rendu par l’article de Frédéric Gonin, Violence feinte ou violence réelle ? Le topique du Sturm und Drang dans la musique du XVIIIe siècle à l’épreuve des idéaux classiques de vraisemblance et de bienséance, qui présente ce que l’opposition à l’esthétique des Lumières, au seuil du dernier tiers du siècle, le rejet du classicisme par la volonté de dynamiser la pensée des Lumières via la dénonciation des conventions morales, put contenir de violence à l’époque. Faisant nettement distinction entre Sturm und Drang et musique Empfindsamkeit, Gonin précise que « l’application de l’expression Sturm und Drang à la musique d’Haydn n’est pas usurpée, bien qu’elle reste hypothétique ». Les rythmes agités convoqués par ce courant, la densité des textures, le mode mineur, la déclamation outrée et un chromatisme souvent dissonant firent violence à l’auditeur. « Cette violence est-elle feinte de la part d’un compositeur/artisan qui, avec plus ou moins de réussite et d’originalité, applique des recettes communes, ou est-elle vécue par un artiste créateur sous l’impulsion de ses propres sentiments ? » – telle est la question…
Voilà un essentiel à toute bibliothèque respectable !
BB

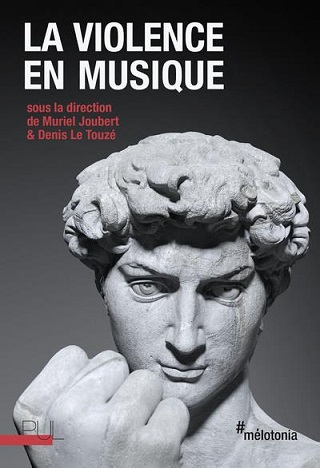
 Email
Email
 Imprimer
Imprimer
 Twitter
Twitter
 Facebook
Facebook
 Myspace
Myspace