Recherche
Chroniques
Théodore Gouvy
œuvres variées
Outre le grand travail de défrichement et de diffusion entrepris depuis de longues années par l’Institut Gouvy d’Hombourg-Haut, ville de la Sarre mosellane où le compositeur vécut dans la villa de sa famille, activement liée à l’essor industriel de la région jusqu’en 1930 environ, une relève plus récente s’est très significativement engagée à faire mieux connaître la musique de Théodore Gouvy, grâce au Palazzetto Bru Zane [lire nos chroniques des 10 juin, 19 et 17 mai 2013]. Alors que leurs ainés étaient nés Français, avant que la chute de Napoléon entraîne la perte de ce territoire, Alexandre et Théodore, les plus jeunes, naquirent Prussiens. Le musicien vit le jour non loin de Sarrebruck à l’été 1819, mais fut élevé à la mode française – à Sarreguemines (collège) puis à Metz (lycée), enfin à Paris (faculté de droit) où malheureusement sa nationalité, alors qu’elle ne fut en aucun cas délibérément choisie mais le jouet des découpages politiques du temps, ne l’autorise pas à entrer au conservatoire, réservé aux seuls Français.
De cette adversité résulterait une facture artistique ô combien « fortunée », Gouvy étudiant du coup avec quelques maîtres français mais aussi effectuant plusieurs séjours en Italie et, surtout, en Allemagne dont il absorbe volontiers la culture. D’après Sylvain Teutsch, qui signe l’un des passionnants chapitres de ce livre-disque inaugurant la nouvelle collection Portraits du Palazzetto Bru Zane, le musicien revendiquait lui-même cette richesse particulière d’une « bipolarité » frontalière, omniprésente dans son œuvre qui conjugue les traits propres à chaque rive du Rhin.
Lorsque leur mère disparaît (1868), Théodore s’installe à Hombourg-Haut avec son frère Alexandre, devenu patron des fonderies. C’est dans ce confort retrouvé et sans se soucier désormais des aléas du petit monde parisien de la musique qu’il compose ses pièces les plus abouties – ainsi pourrait-on voir les choses aujourd’hui, mais elles n’allèrent pas si facilement, pourtant : la guerre éclate en 1870 ! Les années qui suivent sont paradoxalement marquées par une influence plus frappante de la tradition française dans son œuvre, alors même qu’elle est plus volontiers jouée dans les grandes cités germaines que sur nos scènes, si ce n’est dans un petit cénacle d’amis musiciens qui en reconnaissent l’inspiration et le talent (voir le chapitre d’Olivier Schmitt). Tardivement reconnu par ses pairs, Théodore Gouvy s’éteindra à Leipzig au printemps 1898, sa dépouille étant enfouie à Hombourg, en terre natale.
Avec cette parution à la fois précise et concise, le Centre de musique romantique française de Venise introduit parfaitement à la redécouverte de la musique de Gouvy, encore trop rarement jouée [lire notre chronique du 28 mars 2012]. Au fil de trois articles qui font autorité (les deux déjà cités, ainsi que Le Mendelssohn français par Alexandre Dratwicki), étayés de lettres du compositeur à son confrère Théodore Dubois et de Pensées personnelles extraites de divers documents puisés dans la thèse soutenue en Sorbonne par Martin Kaltenecker en 1986, sans les vers du poète picard Charles-Hubert Millevoye sur lesquels fut composée en 1875 la scène dramatique La religieuse – comme à son habitude, l’institution offre tous ces documents en version anglaise [lire nos critiques d’Andromaque, d’Amadis de Gaule, de Renaud et de Sémiramis].
Grâce à ces trois CD, l’auditeur se fraie un chemin plutôt fluide dans la riche production de Gouvy. Avec les Quatuor en ut mineur Op.68 n°5 (par le Quatuor Parisii), Quatuor en la mineur Op.56 n°2 (Quatuor Cambini) et Trio en sol majeur Op.22 n°4 (Trio Arcadis), aperçu lui est donné de la production chambriste, extrêmement développée par ailleurs. Afin de rendre compte du vaste catalogue pianistique, ici radicalement concentré en six des vingt Sérénades (publiées entre 1855 et 1874), sous les doigts d’Emmanuelle Swiercz [lire notre chronique du 17 décembre 2004], peut-être aurait-on pu oser un quatrième disque… Sans plonger dans les six symphonies de Gouvy, la maîtrise orchestrale est bien présente, à travers les ouvertures de concert Jeanne d’Arc (1858), Le festival et Le Giaour, superbement jouées par Jacques Mercier à la tête de son Orchestre national de Lorraine, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège livrant sous la battue de son chef titulaire Christian Arming des pages intermédiaires comme la Fantaisie pastorale (Tedi Papavrami au violon), l’élégante Sinfonietta Op.80 et la fort émouvante Religieuse (avec le mezzo-soprano Clémentine Margaine).
Indispensable !
JO

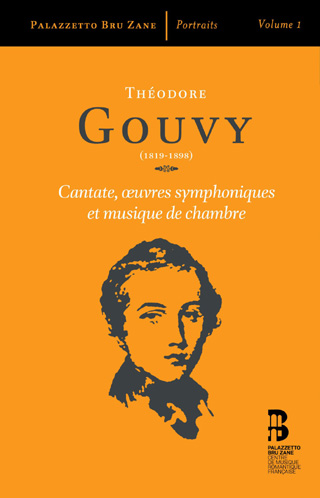
 Email
Email
 Imprimer
Imprimer
 Twitter
Twitter
 Facebook
Facebook
 Myspace
Myspace